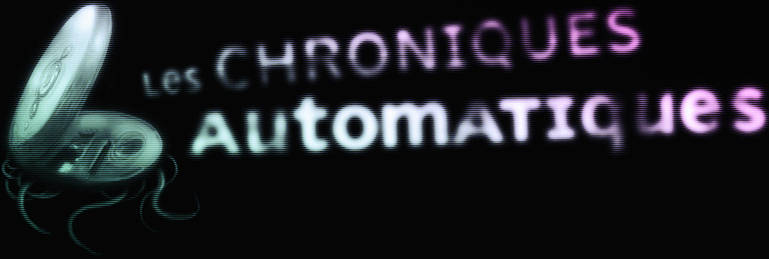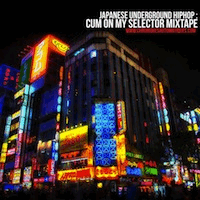Je ne te vois plus nul part, sauf quand je ferme les yeux
Toujours difficile d’aborder un album de Sufjan Stevens. L’homme fatigue autant qu’il me fascine. Et pourtant, je l’adore ce beau brun. Il y a d’abord la fâcheuse manie de l’américain à trop en faire, que cela soit dans les concepts d’albums (je te sors 6 disques sur Noel, un concept album sur une autoroute, voir un remix acoustique d’un album electro expé sorti il y a 10 ans) ou dans les morceaux eux mêmes : on n’est jamais à l’abris d’une flute étranglée ou d’un twist musicalo-kitsch gâchant une fresque bien émo. Digne d’un field recording dans le centre de ville de Nantes, captation live des groupes d’indiens présents dans le monde entier.
Alors forcément, quand tous les médias nous annoncent un album centré sur sa mère qui vient de passer l’arme à gauche, avec un “retour aux sources” folk christique, on flippe un peu, même si Sufjan sait mettre de la légèreté dans le mortuaire. Et comme souvent, beaucoup n’ont fait que copier coller un communiqué de presse, car ce nouveau Sufjan est tout sauf un retour aux sources. C’est une continuité, un aboutissement, une première pour Stevens : un pur album pop. Enfin.

On va faire simple. L’album aligne des pop-songs fragiles de toute beauté. Mais que ceux qui aiment le coté expérimental et électronique de Suf ne partent pas en courant. Car Carrie & Lowell reste foncièrement électroniques. Claviers lunaires, passages ambiants, légers tourbillons synthétiques, très rares sont les morceaux entièrement guitare-voix. Certes, il n’y a pas d’excavation drill’n bass comme sur le dernier album. Dommage ? Peut être. Mais il n’y a plus non plus les xylophones ou les flutes world music traumatisantes, et ça, c’est un soulagement.
Mais surtout, il y a des putains de chef d’œuvres sur ce disque. Des morceaux qui te prennent la gueule, qui filent la frousse et fracasse la colonne vertébrale. Des vignettes parfaites, tout en retenue, bourrées de légers détails à filer le vertige.
Le meilleur exemple est surement All of me wants all of you. Première note de guitare, tu sais que tu vas te prendre un coup de coude dans le thorax. Meilleure mélodie de l’année, alors qu’il n’y a qu’une gratte poussiereuse. Sufjan hulule calmement, chante des lyrics de dépressifs désabusés qui flinguent le palpitant. Mais surtout, le morceau ne fait que monter, monter, monter, à base de légères lignes électroniques, d’une voix ou cordes plus appuyées, avant un décollage de fin christique affolant. Refrain, chœurs lointains, ouverture lumineuse : si tu ne pleures pas, c’est que tu es un putain de salopard insensible. Il y a tout sur ce morceau de Sufjan, ce coté tire-larmes pur et dur, aucune surprise dans le morceau en lui même. La vraie satisfaction, c’est d’entendre, pour la première fois depuis Chicago, un vrai tube de la part de l’américain. Un morceau qui devrait passer en radio, être synchronisé dans les films, chanté dans les rues du monde. Tout le peuple chialerait et ça serait beau. Tube de stade oui. Mais magnifique, le tube. Perfection. Pourquoi perfection ? Parce que c’est l’équilibre parfait, le morceau qui te donne autant envie de t’arracher la peau de tristesse, et de courir avec un sourire gigantesque parce que tu es heureux.
Et le plus drôle, c’est que ce bordel est loin d’être le seul miracle du disque. Tu n’as pas fini de t’en prendre plein la tronche mon ptit loup. Drawn To The Blood, juste après, commence aussi de façon désertique, avec guitare voix, parfaite à chaque “How ?” filant la chair de poule. Rien d’autre, tu t’attends a une simple folk-song tristounette mais drôlement belle, mais le morceau s’arrête subitement pour partir dans une elecronica-ambiant à chialer sa mère. Cathédrale de synthés cristallins, montée en puissance jusqu’à strangulation. Bizarrement, ce passage m’a fait pensé à la fin du morceau Old Artist d’Archive, un retour vers le passé bien émo. Vraie mandale.
Attends attends, un peu plus bas, tu as Forth Of July, morceau sépulcral, le seul sans guitare, entièrement électronique. Tu as l’impression d’entendre un The Seer’s Tower upgradé, une fresque magnifique noyé sur un piano et synthés ambiants, avec un Sufjan Stevens affolant de justesse. Chaque feulement aigue de sa voix me fait frétiller du cul comme une groupasse de 1Direction, j’en ai presque honte. Mais bordel, comme c’est beau. Quand il te balance “My little versailleees” et que le morceau s’envole seulement pour dix secondes, j’ai juste envie de me planter les ongles dans la gorges histoire de me débarrasser de cette boule à sanglot au plus vite.
Alors tu vas me dire “ouai Dat’, tu exagères, c’est beau, mais là tu pars en couilles et tu éxagères, comme souvent”. Et tu as raison. Mais il y a le sujet du morceau. D’habitude, je ne m’attarde pas vraiment sur les lyrics, parce que chacun les interprètes à sa manière. Mais là, c’est une conversation entre une mère en train de caner dans son lit d’hôpital, et un fils qui s’étouffe de tristesse. Et vu que Sufjan a toujours fait, au niveau de ses paroles, dans le documentaire ultra réaliste, bien que poétique, ben forcément, ça me renvoie à mes propres démons, et aux chambres d’hôpital dégueulasses où ton bonhomme disparaît. Il oublie de dire que les chambres d’hôpital où les parents meurent, ça pue. Surtout dans les bâtiments pourris de Bretagne. Mais pour le reste, c’est plutôt pertinent.
Alors tu as la fan-base pratiquant la fellation sur Sufjan 24 sur 24 qui va te dire que les paroles en mode “we all gonna die” sont belles, et qu’il a trop raison, l’humanité est voué à disparaître pouet. Mais le but de cette phrase, ce n’est pas ça. Le but, c’est de te faire bouffer ta merde, parce que ce “we all gonna die” est tellement bien chanté, tellement bien lâché en fin de parcours, qu’il te donne envie de te faire sauter le caisson direct. Je ne parle pas des lyrics, je parle juste du chant. Bref, le mieux à faire après ce morceau, c’est de lancer un morceau du dernier Migos ou Booba, parce qu’à part te filer l’envie d’aller tester l’aérodynamisme de ton enveloppe charnelle entre le 13étage de ton immeuble et l’asphalte pisseuse en bas, ça va pas t’enrichir des masses. A chaque fois que tu écoutes ce morceau, tu es littéralement hanté par tes morts qui viennent te caresser l’échine. Va te faire enculer Sufjan. Mais dieu, que ton morceau est beau.
Carrie & Lowell, tout joyeux au départ, quasiment mielleux et guimauve, jurant avec les sommets de dépression désabusées précédentes, choquerait presque. On se croyait presque dans une fête foraine. Mais sépia, la fête foraine, parce que tu sens qu’il y a un moignon de caché quelque part, un truc vicié, quelque chose qui ne va pas du tout derrière le banjo mignon. Evidemment, sans que tu t’en apercoives, de façon discrète, le morceau glisse vers le christique, avec un deuxième tiers lumineux, oui, mais à chialer, comme toujours. Et voilà qu’après un refrain de folie, le morceau se brise complètement, et part dans un ambiant funèbre, avec pour seuls compagnons un synthé rongé par la solitude, et un piano qui n’égrène que quelques notes. Une minute où tu as le temps de maudire mille fois le chanteur pour te filer un bourdon pareil. Hey Suf, on avait dit mollo sur le pathos, mollo sur le pathos, mollo, mollo, mollo sur le pathos.
Sufjan maitrise parfaitement sur cet album l’art de la cassure. Contrairement à ses précédents essais, ou à ses folks songs en mode petits chanteurs de la croix de bois, le mec s’autorise a switcher complètement d’une atmosphère à une autre, à quasiment tous les morceaux. On transforme les pop-song quasi Taylor Swiftiennes en monuments dépressifs. On plonge le folk enjoué dans un océan ambiant noir comme la mort. Et l’on ouvre les portes du paradis en fin de petite vignette mignonne. Attention, les tracks ne se servant pas de tour de magie n’en sont pas moins réussis (No Shade in the shadow, mystique ou Jon My Beloved en sont de parfaits exemples), mais les brusques surprises sont forcement plus marquantes :
Parce que certaines conclusions sont dignes d’un Shyalaman : Death With Dignity joue la sagesse acoustique, avant de faire intervenir des chœurs marins pas marrants. Should Have Known Better balance l’un des plus magnifiques morceaux créé par l’américain, c’est beau, c’est cool, c’est triste, et hop, tu as milles anges qui déboulent sur tes tympans pour faire sauter ton cerveau, qui ne sait plus comment réagir devant ce tsunami guimauve parfait.
On a parlait de All of me wants all of you, pop song dingue qui vrille en mode voyage vers la lune, reléguant Interstellar au rang de vulgaire reportage de France 3 sur un planétarium dans l’Hérault. Ou de Drawn To Blood qui ferait bander Varys avec sa deuxième moitié ambiant caverne de glace. Mais tu as aussi et surtout Blue Bucket Of Gold, superbe conclusion d’album, berceuse au piano qui va soudainement partir dans une electronica limpide, lumineuse, vagues de synthés fous, habillée par des “wouououuuu” à s’arracher le cœur. Putain de merde, j’ai eu le vertige en écoutant ce morceau, la première fois. Allongé sur un lit, 4h du mat, retour zombie de boite de nuit, la musique à fond, à moitié plein d’alcool, je ne m’attendais pas à cette pause soudaine, à ce silence d’une seconde, avant ce décollage affolant, indescriptible, qui a littéralement violé mon cerveau. Adieu mon pays. Fantômes, pluie et femmes nues, c’est ça, les deux dernières minutes du disque.
Je n’avais pas envie de le dire, mais je vais quand même lâcher le morceau. Il me semble que ce disque est le meilleur album de Sufjan Stevens. Parce que pas une fois, j’ai eu envie de passer un morceau (peut être Eugene, seul moment moins passionnant). Parce qu’il est complet, court (11 morceaux), et sublime de bout en bout. Parce que ce disque est la continuité parfaite de Age of Adz, Suf reprend exactement là où il s’était arrêté. Son précédant disque se terminait avec Pleasure Principles, tout petit morceaux à la fin d’une fresque de 25 min gargantuesque. Tout petit morceau oui, mais pop song absolue, sublime, un des meilleurs morceaux du mec. Carrie & Lowell, c’est exactement ça, c’est la suite, c’est l’ouverture. Des chansons toutes simples, toutes belles, timides, évidentes.
Parce qu’il n’est pas avare en retournement de situation, parce que chaque morceaux semble être l’aboutissement de centaines de morceaux fait par Sufjan auparavant. Comme si le mec avait tout testé pendant sa carrière, avant de balancer un disque définitif sur un sujet qui le hante, sa mère, sa mort, et les souvenirs avec son fantôme.
Forcément, ce n’est pas un album à écouter quand tu ne vas pas très bien, parce que même si les flingues ne sont pas légaux dans ton coin, tu vas vouloir te dégotter un calibre aussi rapidement qu’un camé en manque de Méthadone. Certes. Mais passé la tristesse, c’est aussi un album lumineux, chaud, beau, touchant et touché par la grâce. Parfois joyeux. Désabusé, toujours, mais joyeux. L’ambivalence d’un morceau comme All of me wants all of you, véritable diamant, symbolise parfaitement ce Carrie & Lowell LP, hésitant constamment entre cercueil empli de larmes et souvenirs ensoleillés.
C’est le plus bel album tombé sur ma gueule depuis le début de l’année, et dans le genre, on peut affirmer tranquillement qu’il n’y aura rien de mieux, rien de plus aboutit en 2015.
Sufjan est bien assis sur le trône, et personne ne viendra squatter ses genoux. Il vient d’accoucher d’un monument.
11 morceaux – Asthmatic Kitty
Dat’
TWITTER (vient parler armes à feu sur Twitter)
This entry was posted on Sunday, April 26th, 2015 at 11:42 pm and is filed under Chroniques. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Powered by WordPress v 6.1.6. Page in 0.804 seconds.