
This entry was posted on Wednesday, May 13th, 2009 at 5:34 am and is filed under Chroniques. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Powered by WordPress v 6.1.7. Page in 0.718 seconds.

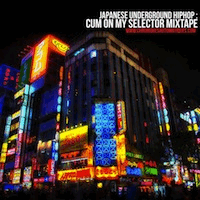
J’ai découvert World’s end pendant mon voyage au japon l’été dernier.
C’est tout simplement une des plus grosse claque musicale que j’ai pu avoir.
Je n’ai pas ce disque, je vais le chercher de ce pas.
Trés bonne chronique Mr Dat,
Peace
Superbe album, belle chronique
et merci pour le merci 🙂
Je rajoute une petite note pour dire que je suis en train d ecouter le nouvel album de Jon Hopkins “Insides” et c est MA-GNI-FI-QUE!!
j espere une petite chronique dessus si l album te plait autant qu a moi
Yo Dat’,
Putain, j’ai mangé ta chronique en voyant World’s end girlfriend en haut de la page !
Pareil que Wony, WEG m’a mis une claque monumentale musicalement parlant.
Excellente chronique par ailleurs. Tu viens de faire gagner des sous à Mr Maeda…
Et merci pour le son, je m’en vais le dévorer de suite.
A +
@ K –> tu viens aussi de me conforter dans mon choix d’aller choper le dernier Jon Hopkins !
@ Tous ==> Héhé à croire que World’s End Girlfriend est un passage obligé pour ceux qui vont au Japon ^^
K => Jon Hopkins, pas encore écouté, mais tout le monde en dit que du bien !
J’aime beaucoup la pochette d’ailleurs…
Je ne peux qu’encourager tout le monde à se procurer les albums de ce monsieur. Chacun d’entre eux est un véritable don du ciel, un diamant brut.
Jon Hopkins est un maitre aussi dans son genre, tous ses albums sont excellents.
@Dat’ : just keep on moving men, tes billets ont une legère tendance à hypertrophier mes glandes salivaires.
Et mon portefeuille te hait.
This is the appropriate blog for anybody who wants to find out about this topic. You understand so much its almost laborious to argue with you (not that I truly would wantHaHa). You positively put a new spin on a subject thats been written about for years. Nice stuff, simply nice!
gshistory com 2013 03 12 juliette gordon low gets another wax likeness
Rebecca Bextel Mountain Business Center https://goo.gl/h4qkT8