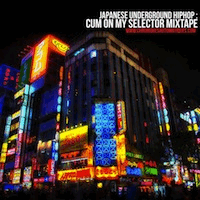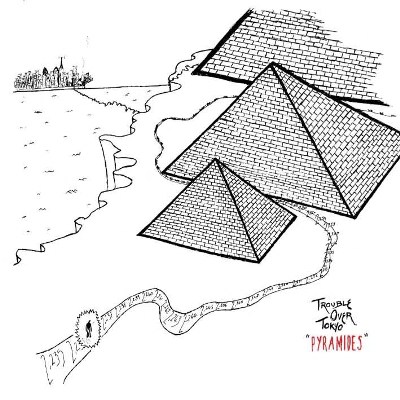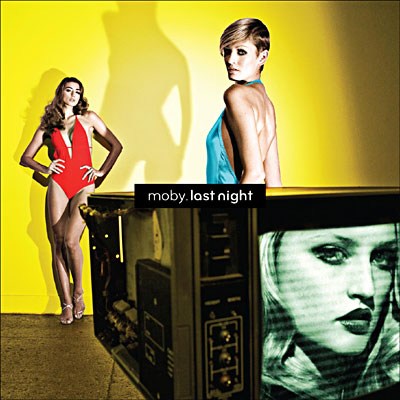Nuits Sonores 2008 / 07 Mai au 10 Mai.
On ne va pas garder le suspense trop longtemps. Les Nuits Sonores 2008 on été un grand cru. Pourtant il était difficile de rivaliser avec l’affiche proposée l’année dernière. Mais il suffisait d’un seul nom pour me draguer sans ménagement : Dj Krush.
Pour les jours à venir, deux ou trois articles donc, mais pas sous forme d’un compte rendu “jours par jours” comme l’année dernière. En Teaser :
/ Les pensées jetées sur papier ce soir
/ Des vidéos qui vont changer un peu des sempiternels trucs pris entre trois mille personnes avec le musicien en schtroumf à l’horizon.
/ Des photos floues pourries et des photos nettes cool.
/ Une interview.
/ Deux titres enregistrés d’une façon pas trop pourrave, dont un inédit ( ??) de Dj Krush.
/ Quelques anecdotes et petits bonus.
Reality Check
– Bon déjà, quelque chose a sûrement frapper pas mal de festivaliers. Le cadre du point “central” des Nuits sonores. L’année dernière, c’était les subsistances, ancien couvent avec une verrière de folie, permettant de voir le ciel s’éclaircir à l’aube tout en étant au chaud, à sauter dans tous les sens. Cette année, l’Usine SLI, ancienne usine d’ampoule super crade, grise, façon Basement au troisième sous sol d’une rave party sortie du clip No good de Prodigy : Gros poteaux en métal au milieu des salles, vieux néons pendouillants vibrant au son des basses, c’est pas ici que l’on ira faire une thalasso. Pourtant la magie opère en un claquement de doigt. Tout le monde se marre, danse, c’est super bon enfant, si l’on excepte le mec qui veut vomir et la demoiselle dans sa jolie robe à fleur qui semble avoir le Space Mountain devant ses yeux. Sinon niveau logistique, le site de 2008, c’est 3 salles, plus un espace plein air, sorte de hub central reliant les différents points, et une orgie de bars ( 5 je crois bien) Sinon les chiottes sont toujours aussi épouvantables.
– Donnée importante, j’ai eu la chance d’avoir le sésame “Pass Presse” cette année. Ce qui m’a permis d’apprendre, notamment, que les journalistes aiment bien le champagne (certains boss de magasines vont bien rire en voyant l’addition), que les mecs sont carrément sympa quand il s’agit d’aider quelqu’un d’un peu paumé, et que le bar presse, c’est drôlement pratique quand 500 personnes veulent prendre un verre au même moment sur les autres oasis de boisson.
Sinon tout le monde vous trouve plus sympa quand vous avez un badge, bizarre…
L’usine SLI avant les concerts…
– Premier nuit, arrivé un peu à l’arrache façon Taxi-en-trombe-dérapage, 10 minutes avant le début d’Underworld, qui était inratable. Jun Matsuoka balance de la bonne grosse Drum & Bass, ce qui accentue le coté ‘tain je suis dans une Tech clandestine ou quoi ? lors de la découverte de l’usine. Bon pour Underworld, cela faisait un bail que je ne m’etais pas replongé dans leurs compos, oubliant même les titres des morceaux les plus connus (excepté l’inénarrable Born slippy), et n’ayant que survolé leurs dernier album. Justement, c’est ce dernier qui sera pas mal mis à l’honneur sur le live, avec pas mal de compos bien calmes, bien planantes, tous synthés dehors…
————–
– La soirée qui me draguait depuis pas mal de temps, c’était la spéciale Jarring Effects du jeudi, en circuit électronique (donc gratuité oblige. Ils font les choses bien chez Jarring) La programmation, pour les amateurs du label lyonnais, avait de quoi faire tourner les têtes, avec notamment un live d’ Ez3kiel, et surtout le groupe Dalek. Bon sinon le concert d’Ez3kiel était en fait annulé.
– Bon en l’absence des précités, Dälek devenait évidemment l’attraction de la soirée. La chose bien connue, et le groupe le revendique même lors de leurs interview, c’est la puissance sonore de leurs Lives qui dépassent les limites de la compréhension humaine. Pour le coup, merci d’avoir prévenu, le live ne lui-même frôlait l’insupportable d’un point de vue volume. Obligation pour moi de rester à la frontière de la salle, collé contre le mur du fond, avec en bonus des Boules Quies vissées dans les oreilles. Pour le reste, concert de folie avec des basses tonitruantes, des grondements vous frappant directement le bide, écrabouillant vos viscères. Presque plus physique que sonore. Un guitariste se greffe au groupe pour balancer une masse sonore encore plus ahurissante, et on partira au dessus des nuages lors du titre magnifique Ever Somber, permettant de frôler le paradis après avoir plongé directement en enfer. Le public, par contre, visiblement apeuré par l’attentat musical, préfère se réfugier au bar extérieur et fuir une salle qui se vide progressivement. (Un pote a même cru que le plafond lui tombait sur la gueule lors d’une attaque sonique en règle) Très très bon live de Dälek, fascinant même… mais clairement abusé niveau volume.
– C’est REVO qui va réconcilier le public avec la scène. Comme le laissait présager leur très bon Artefacts…/ fraîchement sorti, les deux mecs de Morlaix ont balancé un live de folie où machines se fracassaient avec un sourire pervers sur des murs de guitares. Salle pleine à craquer en un quart d’heure, ambiance de folie, concert ultra énergique et défoncé, avec des montées en puissance (le point le mieux maîtrisé sur leur disque) à rendre dingue n’importe qui. Les gens sont unanimes : meilleur Live de la soirée, et de loin. Pour Fumuj, ce fut aussi excellent que sur disque (foncez sur leur énorme The Robot and the chinese Shrimp), avec ce mélange d’Electro, Hiphop, Punk, Funk et Dub (bien que ce dernier aspect fut un peu éludé en live pour donner quelque chose de plus frontal). Bref, c’est l’incendie, ça saute de partout, et on part tous en couille quand le groupe modifie son Play My fucking shit pour le tirer sur plus de 20 minutes. Brain Damage enfin, avec un concert plus classique, avec une orgie de samples ethniques bourrés de reverbs et basses Dub claquants comme un marteau sur un bloc de glace. Parfait pour finir la soirée.
– Les navettes gratuites, c’est cool, mais quand elles prennent les virages à 90° et les dos d’âne à 80Km/h, c’est moins cool. Quand on est obliger de s’envoyer des bonnes Rillettes sur des Pancakes bien sucrés de Pasquier parce que l’on a plus de pain, c’est pas super cool non plus.
… et pendant les concerts !
———–
– Dj Krush Dj Krush Dj Krush. Je me suis réveillé (difficilement) en pensant à Dj Krush. J’ai mangé Dj Krush. Je me suis douché Dj Krush. Mais sur Vendredi, il n’y avait pas que lui en tête d’affiche. A dire vrai, toute la soirée de vendredi était juste à tomber, essentiellement sur la Salle 3, qui m’a hébergé sans discontinuer de 22heures à 5 heure du mat non stop. Sans compter que Laurent Garnier et Agoria étaient prévus pour un long “Versus” de 7 heures dans la grande salle.
– Première mise en bouche bien sympathique avec le concert de Manimal, dont j’ai déjà dis tout le bien que je pensais de son Back to The Primitives, toujours dispo gratos en téléchargement sur son site. Perf bien classe, avec un Dj Bonetripps toujours aussi cabotin, et un Time parfait pour conclure. On aura même le droit à une apparition des Gourmets pour un morceau. Deuxième live méchamment attendu, Playdoe, aka Mc Spoek et l’ineffable Dj Fuck (Sibot) . Vu comme son album avec Mc totally Rad était juste une tuerie absolue, indispensable pour tout amateur de Hiphop electro déglingué, j’attendais avec une excitation non feinte de voir le mec sur scène. Et malgré un Mc moins affolant que Totally Rad, le tout était carrément jouissif, avec une variété d’instrue caractérisant bien Dj Fuck/sibot : Hiphop bien gras, 8bits débile ou électro bien barge. Pour avoir pu parler un peu avec Mr Dj Fuck plus tard dans la soirée, le mec est en plus super cool. Un peu plus et je tombais amoureux.
– Lumière éteinte, salle comble, presque étouffante. Dj Krush fait son entrée, armé d’un laptop et de platines. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre, et aller à un live alors qu’on vénère un type depuis des années n’est pas toujours la meilleure des choses à faire histoire d’éviter le risque de tomber de haut. Hey bien pas déçu. Impressionné même. Le mec arrive à saccader, défoncer ses propres morceaux (ou ceux des autres, Dj shadow par ex) d’une façon renversante. Le set/live était super éclectique, passant du hip-hop à la Drum & Bass en un claquement de doigt, pour partir dans un final quasi apocalyptique : averse de saturations, à-coups et explosions rythmiques. Merci pour la claque.
– Pour Battles par contre, c’était plus bonnet de nuit que claque dans la gueule. J’avais pourtant vraiment apprécié leur Mirrored, mais en live, le tout fut bien bien froid, et pas foncièrement engageant. Pourtant les éloges sur leurs performances en Live fleurissent sur le Net. Etonnant. Bah cela aura permis de refaire tomber le soufflet avant le Live mega attendu d’Antipop Consortium, reformé après 6 ans de Split. Au menu, morceaux inédits du futur album (qui semble bien électro) et classiques qui rendent fou l’assistance (Ping Pong notamment). A noter l’absence de Beans pour le concert, passée presque inaperçue tant le groupe a habilement réinterprété les morceaux pour qu’ils paraissent naturels avec deux Mc…
Le site en exterieur
– Petit détour pour finir la soirée sur le Versus de Laurent Garnier et Agoria. Et je ne sais pas si c’est l?accumulation de bières ou la playlist parfaite des deux Monsieurs, mais le pied fut monstrueux sur la dernière heure. Guettez ces pages, je vais mettre ce weekend une vidéo sympathique de ce Live (entre autre)…
———
– J’ai compté patiemment, au réveil Samedi matin (ah ah), cela me faisait un joli résultat de 11 heures de sommeil en trois nuits. N’étant plus le jeune fougueux et pimpant d’il y a quelques années, je peux vous dire que le tout commençait sérieusement à peser sur l’organisme. Bon, malgré un mal de crâne intense et un ventre qui semble avoir disparu par manque de nourriture (C’est bien d’oublier de dîner la veille, je ne me rappelle pas avoir pris un coup de fusil à pompe dans le bide, mais cela faisait le même effet) Je ne voulais louper sous aucun prétexte le point presse de Laurent Garnier et Agoria. L’occasion de errer un peu dans le Palais de la bourse de Lyon, investie par des Dj et des vendeurs de disques. On essaie le fameux Tenori-On, puis on va se balader aux gres des rues de Lyon, transformée en ville électro le temps d’un Weekend. Pleins de bars crachent de la Techno à plein tube, des gens dansent dans la rue et tout le monde se fend la gueule.
– Le temps déchouer sur les berges du Rhone, et de tomber sur la NS block Party II toute basses dehors du debut d’aprem, jusqu’à 22heures. Super moment. Peut être même le meilleur moment de toutes ses nuits sonores. (bon je n’ai pas fais la soirée du Samedi soir malheuresment) On se prélasse au soleil (écrasant) sur les marches en écoutant le hip-hop balancé par Dj Spy et Dj Bubbz. Mais le soleil fait des dégâts sur une caboche bien fatiguée, je préfère battre ne retraite et revenir plus tard, à chaleur déclinante. Ce qui me fera louper, sans le savoir, Dee Nasty et les Gourmets. Youpi. Mais rien de grave au final, au vu de la suite. On s’installe donc pépère, avec de quoi se sustenter, et on se laisse bercer par la Techno-Pop-Hardcore-hiphop balancée par Dj Gero. Le soleil se couche petit à petit, alors que les danseurs deviennent de plus en plus nombreux. Et là, j’assiste à un tableau presque utopique : Tous le monde danse, tout le monde se mélange, se marre, Du jeune Tecktonikeur survolté au Rasta encore embué de son dernier joint, en passant par les demoiselles très apprêtées, les mecs torse poil hurlant à la mort, les technivaliers pas rassasiés de leur dernière virée en Bretagne, les jongleurs, les enfants, les parents, les amateurs de Hip-hop, de Techno, de Drum, les passants, les chiens, les curieux, les drogués, les supporters de l’OL, les serveuses du bar à coté, des vieux, et même un couple qui était au départ descendu de chez eux pour acheter deux baguettes de pain. Bref, une espèce de symbiose, d’osmose musicale, avec au dessus des têtes un soleil qui se couche, laissant paraître un panorama sublime.
Presque retourné par cette vision utopique, je décide de lever mon cul, de me mettre sur le pont adjacent, de me plonger dans ce beau tableau une dernière fois, et de rentrer chez moi la boule dans la gorge.
Le panorama que l’on pouvait admirer en dansant pendant la NS block Party II… ça marque…
Hop, next step ce Weekend, des vidéos sympas de ces Nuits sonores !
Dat’