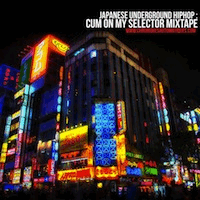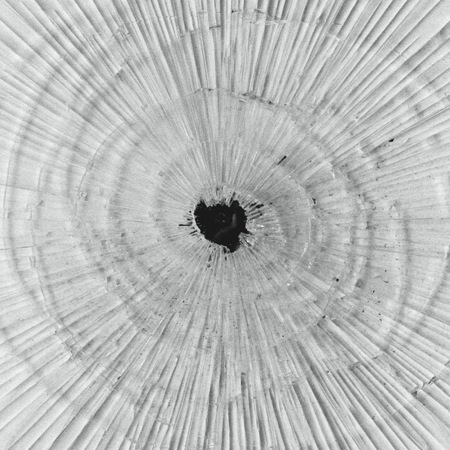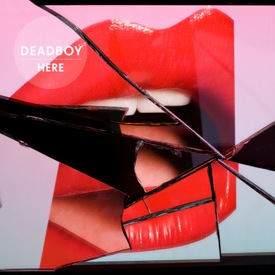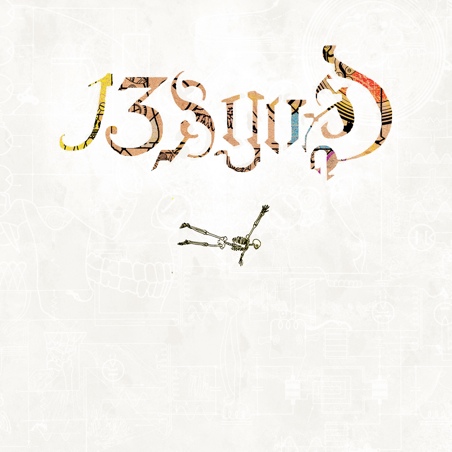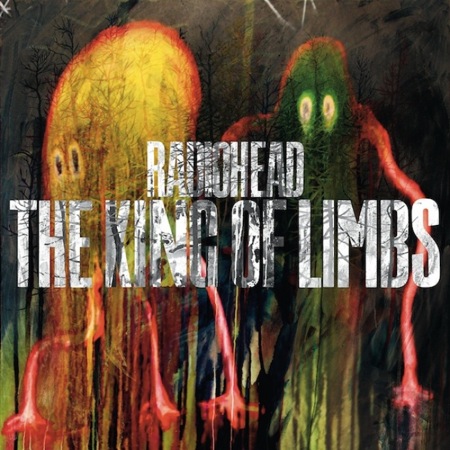Et si tu me revois après ma mort
Ok, je vais avoir du mal à parler de ce qui suit, désolé si l’intro vous semble complètement brouillonne. Pour balayer toute crainte d’une chronique objective, un fait : Plaid doit être mon groupe préféré. Mais paradoxalement, je n’ai PAS d’album de Plaid préféré. Pas de highlight réel dans leur disco, le groupe a toujours navigué pour moi dans des eaux étranges, celles des excellents albums peuplés de très bons morceaux, et d’autres dispensables, cela sur tous les disques. Pas d’album culte donc, pas de “Mezzanine” ou de “10.000 hz legend” chez Plaid, pas de Lp pouvant être plaqué partout comme référence absolue. Des morceaux qui m’arrachent encore et encore la colonne vertébrale, oui, il y en a des camions bennes. Disséminés tout le long de la carrière de Plaid, au grès de leurs sorties. Pourquoi mon groupe préféré alors, si je me trouve dans l’impossibilité de faire du prosélytisme en balançant des “putain mais écoute ce Lp en premier, tu vas voir ça va changer ta vie” (ce qui est en général plus convaincant que “ouai alors écoute le morceau 2 du premier disque, le 5eme du deuxième Lp, le 9eme du…” ) Je n’arrive pas à expliquer cela, et c’est surement le seul groupe, surtout en electronica, que j’aborde sous cette optique, alors qu’il m’est tellement facile de dégager les meilleurs Lp de leurs potes de label… Phénomène intéressant, et paradoxe que je tente d’expliquer en m’emmêlant complètement les pinceaux, c’est que si j’avais à lister mes 10 albums de musique préférés, que j’aime le plus, il n’y en aurait AUCUN de Plaid. Mais pour la question “quel est ton groupe préféré / le plus écouté” je répondrai surement Plaid sans hésitation.
Préféré donc, parce que sur la presque douzaine d’années que j’écoute le groupe, je n’ai jamais été lassé de leur musique. Plaid, je siffle ça sous la douche. J’écoutais ça en allant au collège, au lycée, puis à la fac, puis à l’anpe, puis au boulot. En vacances, la nuit, dans mon lit, sur la terrasse, dans l’avion, dans les trains, en déclarant ma flamme, en coupant les ponts, en soirées bourré, seul dépressif, dans la bagnole avec des potes, en bossant, en ne bossant pas, en tentant de faire des mémoires, en pleurant, en riant, en regardant la tv sur mute, en bouffant, en broyant du noir, en courant vers le soleil. Bref, comme chacun a le groupe “de sa vie”, le mien doit être Plaid, et si mon disque préféré n’est pas de Plaid (mais de qui au juste ?), la musique de ces anglais s’est littéralement emparé de mes synapses, et j’ai énormément de souvenirs en relation avec leurs Lp.
Alors oui, donc ce Scintilli, on l’a attendu à mort. 8 ans. Certes, entre temps, des sorties qui ont pu faire patienter tranquillou, entre un Greedy baby en demi-teinte, une BO d’Amer Béton / Tekkonkinkreet absolument sublime et une autre pour Heaven’s Door sympa mais pas franchement marquante. Forcément, cette attente, elle a exacerbé, graduellement, l’envie d’écouter un disque de Plaid, qui se devait, après tout ce temps, être parfait.

Bon pareil, la suite risque d’être encore un peu brouillonne. Une chronique du nouveau Plaid, j’en ai rêvé depuis que j’ai ouvert ces pages. En 6 ans, je n’ai jamais fait d’article sur les anglais, justement pour que le nouveau disque soit le premier article traitant du groupe. Scintilli commence d’une façon assez étrange, avec Missing, jolie intro cristalline, à base guitare acoustique d’harpe, de voix féminines. C’est drôlement mignon, ça évolue plutôt pas mal, et même si quelque chose me gène dans ce morceau, sans pouvoir réellement savoir quoi (peut être quand le chant change, par ex sur le passage 1min30/38 ). Bref, ça cajole, il y a des clochettes et c’est méchamment émo, comme tout bon Plaid qui se respecte. Et voilà que débarque Eye Robot, track grondante qui ne va nul part pendant 3min, comme si le duo était allé faire une putain de pause pipi en laissant une boucle tourner. Ce n’est pas mauvais, on ne voit juste pas du tout l’utilité de l’escapade, éternelle intro.
On fait un peu la gueule, et c’est là que Thank apparaît, et nous colle un sourire immense. Ce morceau est absolument mortel, pile dans ce que font les anglais habituellement. Plus cinématographique peut être, complètement déstructuré en étant toujours aussi immédiat. L’espèce de synthé-voix qui démarre à la 0min28 me dresse les cheveux sur la tête. Et vlan, voilà que le rythme démarre, la mélodie est dingue, clochettes de partout, cela fuse dans tous les coins, ça tabasse dur et c’est beau à en crever. Pur morceau. Plaid is back. Mais la mandale suprême intervient juste après, avec Unbank, meilleur morceau de Scintilli avec /suspense/. Ce Unbank, c’est la grosse folie. Des les 30 premières secondes, tu sens que cela va être absolument mortel. Mais alors vraiment. La mélodie est IMPARABLE. Tube de stade. Et en plus, ça pullule de détails. Le beat est techno, tape dur. Le morceau part déjà bien haut dans le ciel, les petits oiseaux, ça. Tu le chantes sous la douche, ça aussi. Tu veux l’entendre dans un club. Coup de grâce : la mélopée qui déboule à 2min30. C’est les bras en l’air, les stroboscopes, les ruptures, la bière qui coule, les cœurs brisés et les hurlements de joie. C’est peut être le premier gros tube de Plaid, c’est un exercice que j’adorerai entendre plus souvent de la part du groupe.
ET… et… et… c’est là que les choses se gâtent. Car si Scintilli a des titres qui ont clairement du calibre, et certains petits bijoux, le disque comporte aussi son lot de tracks moyennes. Le premier des maux du Cd, c’est de filer des fresques qui se terminent un peu n’importe comment. Qui ne semblent pas foncièrement avoir de conclusion, qui ne se déplient et n’évoluent pas assez. L’idée est là, mais ne semble pas foncièrement aboutir sur quelque chose de renversant. Tender Hooks, c’est joli, échos, mélodie aquatique, rythme sec. Mais rien de spécial. Craft Nine, même combat, berceuse ambiant qui ne soutient aucunement la comparaison avec 35 Summers, beatless là aussi, mais beaucoup plus riche, belle et réussie.
Founded ressort les sonorités asiatiques mais est à mille lieux de la force émotionnelle d’un B Born Droid. African Woods, typiquement le morceau qui va énerver la majorité des oreilles, se la joue Myopia voir Porn Coconut Co, mais là aussi, sans aucune comparaison avec la superbe incartade sortie il y 10 ans. (Même si la fin du morceau est plutôt plaisante). En plus de sonner particulièrement hors sujet. Talk To Us enfin, plus engageante que les précités, Idm énervée qui n’imprime pas vraiment de direction là aussi, sonnant presque comme une outtake de Quaristice.
Je suis méchant, je tape un peu dans tous les sens, mais des bons morceaux, il y en a évidemment d’autres. Somnl, monstrueux, avec une bassline de fou furieux, des voix qui hululent sur tous les plans, une richesse et un travail du son qui fout le vertige. Sorte de fresque dubstep-cristalline, le morceau bute sérieusement MAIS se termine d’une façon tellement brutale que l’on se demanderait pas là aussi si les mecs ont eu un problème durant l’enregistrement. Comme pas mal de tracks dans Scintilli, ce Somnl aurait pu (du ?) continuer pendant au moins 2 minutes, afin d’aller jusqu’au bout du truc, et nous emporter avec.
Upgrade est presque aussi menaçante, ça sent le Plaid de Double Figure, les sources sonores fondent sur les tympans par milliers, pure Idm dans la plus belle de ses formes. Sous l’aspect presque indus du morceau, la mélodie tente de survivre, n’arrête pas de monter, de prendre de l’importance, tu n’es même pas à la moitié du morceau que c’est déjà épique comme la mort. Le break des trois quarts n’arrange pas les choses, pour finir sur une dernière minute assez incroyable. C’est clairement ce Plaid là que j’aurai adoré entendre tout le long du disque.
Et voilà qu’arrive At Last. Qui ne pouvait pas mieux porter son nom. Oui, At Last, en dernier, ENFIN un morceau qui sonne nouveau, qui copie/colle pas une recette déjà utilisée par le groupe dans ses précédents LP. At Last, c’est un pas en avant, un aperçu du futur, tout en gardant une identité ultra-plaid. C’est un morceau qui ne finit pas de progresser, de se déployer, d’ouvrir grand ses ailes. Piano doucereux, nappes presque trance, voix angéliques, Orbital sous morphine. Quand les claviers commencent à claquer dur, c’est à filer la chair de poule, il y a tellement de choses à entendre, à décortiquer, à écouter dans tous les sens.
Edition japonaise, donc bonus track pour les nippons. Et là, j’ai envie d’écrire un mot que je n’utilise jamais, mais qui convient parfaitement à la situation : lol. Outside Orange, bonus track, (je radote), est absolument mortelle. Elle se classe dans les meilleurs titres de Scintilli, de loin. Et là, je me pose une question : Pourquoi foutre ce morceau génial dans l’édition japonais, que personne, à part les japs et les expats, ne pourra entendre ? Pourquoi recaler ce morceau en bonus, et laisser des trucs pas top du tout comme Craft Nine ou Eye Robot dans l’édition originale ? Incompréhensible. (Je suis bien gentil de me poser cette question me direz-vous, puisque je devrais m’en battre les couilles, j’ai la bonne version). Bref, cet Outside Orange, ça commence par une harpe et des sonorités cristallines, façon Amer Beton, et tu as cette mélodie folle pleine de bleeps, synthé drogué qui déboule, claudiquant, avant de se faire sécher par une drum’n bass dingue. C’est superbe, épique, joyeux et parfaitement taillé. Le morceau n’est pas sans rappeler Malawi Gold, (certaines sonorités identiques, on pourrait croire à une version alternative) mais en mieux, car plus épique, et foutrement sublimé par ce synthé malade. Cela renvoie aux vieux exercices de Plaid, quand le groupe ne se prenait pas la tête, et balançait une mélodie à chialer sur un rythme tout simple, à la Double Figure. Tout ce que j’aime chez ce groupe. Voilà, c’est un peu Double figure Lp vs Tekkonkinkreet Lp ce titre. Top.
Ce nouveau Plaid n’est pas à la hauteur de mes espérances, clairement. Ici, la qualité oscille trop entre l’inoffensif, l’inutile et le génial, ce qui avait déjà été le cas avant. Mais pour une fois les morceaux sont trop courts, beaucoup ne se terminent pas. Et plus qu’une histoire de durée, c’est le fait que certaines idées semblent triturées un peu vainement, pour n’aboutir sur rien de tangible. Pas de progression affolante, moins d’émotion, fins abruptes. Syndrome Quaristice. On a parfois l’impression d’entendre du Plaid un peu fatigué, en bout de course. Toujours de haute tenue, mais manquant de souffle.
Je parle des défauts du disque, parce que j’en attendais monts et merveilles, depuis des années. A la Portishead. Mais ce Scintilli a des qualités. Je suis déjà persuadé que c’est l’un des disques que je vais le plus écouter sur cette fin d’année. Parce que comme ses prédécesseurs, je ne peux pas m’empêcher de lancer un morceau du disque à la volée, pour voyager un peu, rire puis chialer un coup. Plaid balance toujours un condensé d’émotions sur 3 minutes. Et quand le groupe met la gomme, c’est assez incroyable. La sainte trinité de Scintilli, aka Unbank / Upgrade / At Last, plus le bonus Outside Orange, et quelques autres challengers (Thank, Somnl, 35summers… ). Je sais que ce sont des morceaux que j’écouterai encore dans 10 ans, à coté d’autres perles du groupe qui tourneront alors depuis 20 années. Pas qu’ils soient révolutionnaires, incroyables ou novateurs. Loin de là. Mais Plaid sait encore parfaitement se placer sur cet équilibre si dur à tenir, entre divagations electronica et mélodies limpides. Plaid ne veillit pas, comme les anciens Plaid n’ont pas veilli non plus. Certains morceaux d’un Not For Threes auraient pu sortir il y a 15 ans comme dans 5 ans. Et c’est la même chose pour Scintilli, qui ne sonne ni neuf, ni vieux. Intemporel oui, comme toutes les livraisons de Plaid. Impossible à situer dans le temps. Les fresques de Plaid, on a juste besoin de les écouter, dans le désordre, en fonction de sa journée, de ses joies et problèmes. Ces morceaux, ils en font encore sur Scintilli, même si la moitié des cartouches se transforment en balles perdues.
Mais avoir une nouvelle bonne poignée de morceaux à rajouter à l’œuvre de Plaid, quelques tracks de plus que l’on est sur de réécouter machinalement pendant des années, la nuit, perdu dans ses pensées… c’est déjà drolement cool.
14 Morceaux – Warp / Beat Records
Dat’