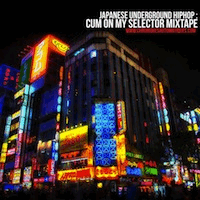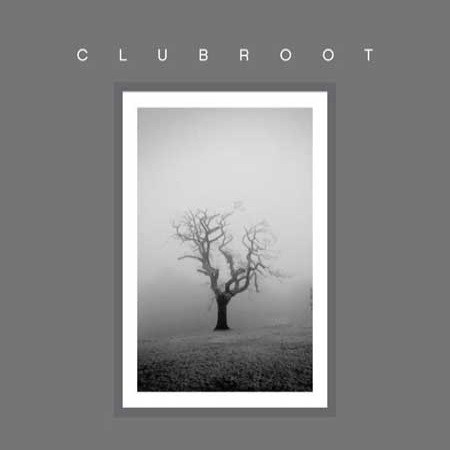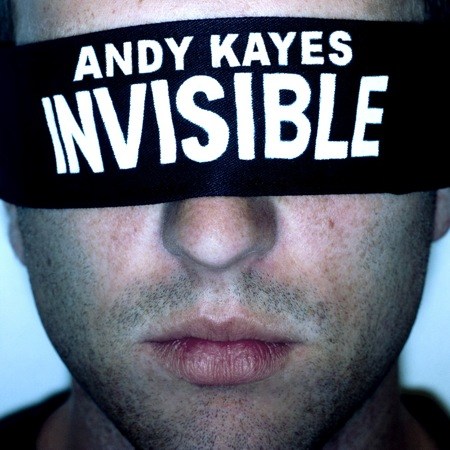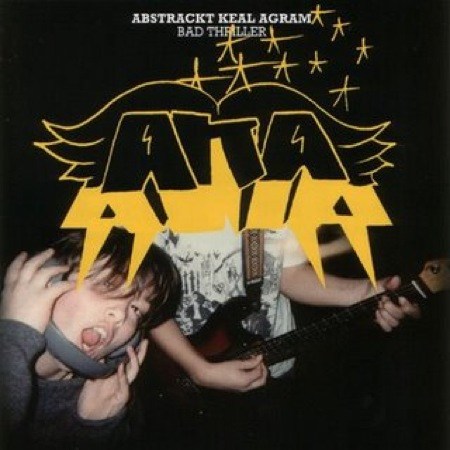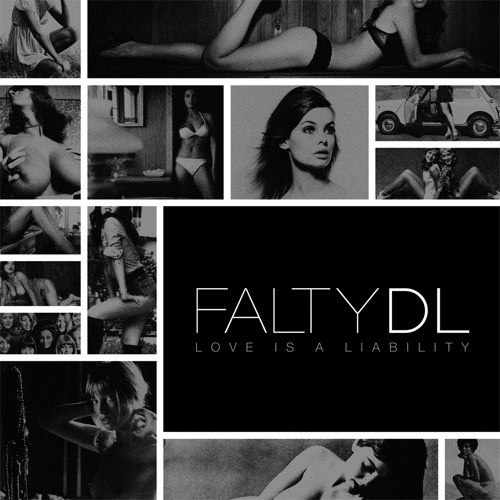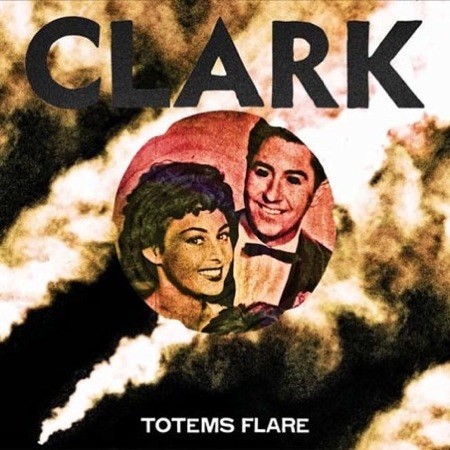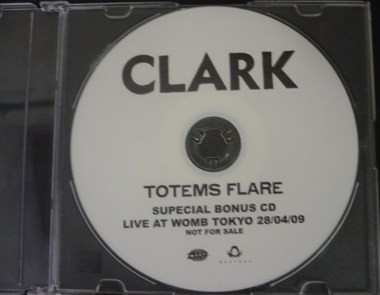I Told You I Was Freaky
Mine de rien, cela fait presque bizarre de n’avoir rien eu de la part de Raoul Sinier depuis 18 mois, alors que le bonhomme nous avait abreuvé de sorties entre 2007 et 2008, entre deux vrais albums (dont l’essentiel Wxfdswxc2, on en le répètera jamais assez), un faux (Huge Samourai Radish, gros Maxi de 12 titres), et trois Ep sur autant de labels différents. Mais Brain Kitchen, son disque le plus radical et violent, semblait marquer un point de non-retour dans la musique de Ra. Tout balancer, tordre et faire hurler ses machines jusqu’à la limite du tolérable. Difficile de continuer dans cette lignée, de continuer de mutiler ses boites à rythme après un truc pareil. Cette longue (tout est relatif) pause semblerait presque être plus une période de vacance exigée par un matos qui a trop souffert, pour des synthés ayant besoin d’un congé, que pour le musicien lui même. Les monstres, corps sans tête, limaces, Whalemen et autres robots se sont peut être rebellés, ont fait la grève avec des petits panneaux, ou plaquant carrément un flingue sur la tempe de Ra pour exiger fissa un voyage sous les tropiques, sous peine de faire la gueule dans les futures vidéos du bonhomme.
Alors en 2009, Ra n’aura comme acteurs dispo qu’un cochon mutant bien fatigué pour la vidéo Transfixed Night, titre inédit parut dans la compile Let’s Kiss And Make Up ( Depth Affect ou Mochipet y sont aussi), première tentative de Raoul Sinier dans le domaine de la pop, et accouchant d’un missile grinçant et déviant.
Et justement, à l’orée de ce Tremens Industry, il semblerait que Ra veuille nous dire que tous ces petits habitant difformes qui squattent de coutume son appart ne seraient que les strictes émanations d’un esprit torturé et halluciné.

Sur la majorité des sorties Raoul Sinier, le sempiternel paragraphe sur le packaging prend souvent toute son importance. Gros digipack avec un Cd et un dvd, artwork traumatisant que n’aurait pas renié Venetian Snares avec une image complètement déviante indescriptible, et (attention) les lyrics des morceaux chantés (Oui, on y reviendra). Coté Dvd, qui est rempli à rabord, on retrouvera trois vidéos inédites, (Dont le morceau titre et son escalope de dinde facétieuse), des tonnes de bonus, ( des Speed Painting, ou le manuel pour construire sa propre guitare électrique de sauvage), un court métrage, un petit clin d’oeil bien cool dans les crédits, et surtout, une bien bonne idée pour tous ceux qui ont galéré pour mettre la main sur les anciens albums de Raoul Sinier :
Surement conscient que la fermeture de Sublight n’a pas du facilité les choses, et que l’encodage Youtube n’est pas toujours top, le Dvd de Tremens Industry renferme carrément tous les anciens clips de Wxfdswxc2, Brain Kitchen et consort dans le dvd. On retrouve donc la bave aux lèvres certains clips ayant pas mal tournés sur No Life Tv ou Canal +, comme le monument Wonderful Bastards, le très beau Breeders Club et sa smoke girl, les flippant Skinfest et 256, ou les plus récents Listen Close Rehersal et Transfixed Night. (Et bien heureusement, Baby Trash)
Tout le monde le dit, et cela saute de toute façon aux oreilles : ce nouveau disque de Raoul Sinier est beaucoup plus calme que le précédant. Il faut dire qu’il était difficile de pousser le bouchon encore plus loin, ou de retenter le même exercice sans risquer de tomber dans la bouillie sonore. Beaucoup moins éclatés, plus étirés, les morceaux laissent bien plus de place aux mélodies, et vrillent moins dans une explosion hysterico-rampante. Pourtant, il est difficile de soutenir que ce Tremens Industry est plus accessible que ses précédant. Car ce disque est malade, il est rongé, il pue la camisole chimique. Les petits monstres qui sautillent de partout, les limaces blagueuses et les Whalemen blagueurs, c’est fini. Ici, on parle d’un cerveau semblant rongé par la parano, les hallucinations, la solitude, grosse descente. Les morceaux naviguent souvent entre mélopées candides et teintes bancales, crades, toujours aussi parasités par la saleté.
Rien que l’ouverture du disque nous fait piger le concept. Overthoughts, c’est pendant 5 minutes une petite litanie presque niaise jouée par un synthé cadaverique, qui se déroule, prend de l’importance, pour déboucher sur des violons. Fanfare rigolote qui se transforme en foire dépressive à mesure que des bruits simili-cris se font entendre. Au final, il ne reste plus que les violons, qui tournent à n’en plus finir, finissant de nous mettre mal à l’aise. Bizarre. Je vous vois venir, oui, on est pas non plus dépaysé, il suffit de se pencher sur Alternative Rush, avec ses grosses perçus caractéristiques, Drum toute cassée, ces claviers lugubres qui tonnent, qui étouffent. Et vlan, sur le dernier tiers, on nous colle un gros tourbillon de synthés histoire de faire degager le tout.
L’album, bien que plus posé, contient toujours quelques pétages de plombs absolus, comme l’inénarrable Map Of A Tactival Nonsense, l’un des meilleurs morceaux de l’album, où l’on entend enfin les machines grogner, se tordre, hurler, se débattre sous les assauts d’un grand malade. Petit à petit, le tout, en son tiers, s’autodétruit, s’écrase, s’annihile, c’est le chaos superbe. On pense que la chanson rend déjà les armes, mais ça va partir dans une espèce de tunnel techno imparable, avec musique épique et rythme pachydermique. Genre les quelques survivants de l’attentat placé en première partie se mettent à courir pour une dernière bataille. La grosse folie.
Mais voilà, rien à faire, le disque est malade. Il est cancéreux, il transpire la crise de nerf, l’araignée dans le plafond. Pas qu’une d’araignée hein, une vraie colonie. Des bouffeuses de cadavres, qui s’infitrent dans tous tes orifices pour te lacérer de l’interieur. On ecoute, on s’en rend pas compte, on est content, alors que les morceaux nous rongent petit à petit. A dire vrai, dans un genre bien différent, ce Tremens Industry me fait penser au Duntisbourne Abbots Soulmate Devastation Technique de µ-ziq (En plus respirable quand même, difficile de faire aussi déviant que ce dernier de toute façon). Comme lui, l’album semble tranquille, posé, parfois presque candide. Mais à chaque fois, quelque chose déconne, quelque chose nous prasite, nous fait flipper. Les morceaux semblent aliénés, altérés, sourire de fin de vie. Et comme le µ-ziq, au premier abord, certaines vignettes passent dans nos oreilles sans se révéler. Le genre d’album qui se fait éliminer directement par les oreilles distraites. Parce que certains morceaux se trimballent la clope au bec, sans but assimilable, sans direction profondément assignée. On ne nous prend plus par la main en nous disant “bon ok, les mecs, sur ce morceau, ça va peter” “hey là, c’est un truc beau juste pour toi”…
Des trucs comme Elle a raison c’est se croire pénard devant la télé avec une bière à la main au départ du morceau, pour se rendre compte petit à petit qu’en fait, tu grattes les murs de ta cellule capitonnée avec tes moignons. Il faut diagnostiquer, piger le problème, identifier la maladie. Ou Tremens Industry, et son rythme Hiphop en roue libre, son synthé grave qui chantonne des graves comme s’il sifflotait en allant acheter du pain. On l’écoute, mais il s’en fout, il se balade, il ne nous prend pas en compte. On le laisserait bien tomber, mais rien à faire, une petite mélodie analordienne, toute fragile, toute belle, s’infiltre dans notre cortex. On pourrait ne pas la remarquer, mais dès que nos tympans s’y accroche, elle devient indispensable, colonne vertébrale gangrenée du morceau.
Overthoughts Reprise aussi, qui relance le titre d’introduction (et qui le sublime), cette montée malade, pour la transformer en cavalcade affolante, avec un beat de tueur, des synthés lunaires, des violons encore plus appuyés, et un espèce d’orgue surgissant d’une église infestée de zombies. Ca fait friser la colonne vertébrale parceque c’est vraiment beau, mais ça te file presque le mal de mer dans le même mouvement. Bande son épique d’un déséquilibré, Braveheart sur un lit d’hôpital.
En plus ouvert et moins éreintant, This Little Mouse accueille de nouveau les violons, qui pleurent au milieu de bugs informatiques, avant qu’un beat pachydermique supplante le tout. Ca continue de vriller dans le fond, les composants électroniques font la foire, les cordes se perdent même si la mélodie est plus lumineuse, rayon de soleil après fin de conflit. Mais comme d’hab, ça va s’étrangler, le rythme s’efface, et le tout crève sur un lit de violons dépressifs et une boucle de synthé hypnotique.
A dire vrai, là où l’album s’envole carrément, là où il expose au mieux cette gangrène mentale, cette espèce de schizophrénie, c’est sur les “chansons”. Oui, Raoul Sinier a fait des chansons pour ce nouvel album, des trucs pop complètement déviant, où il se met même à chanter. Si il y a bien des titres pour exprimer cette dualité rampante parasitant tout l’album, c’est bien ceux là. Et l’on pourrait flipper du résultât (Raoul Sinier, veut faire de la pop, en plus il chante, oh mon dieu) si le monsieur ne nous avait pas rassuré avec son morceau/vidéo Transfixed Night cette été, premier rejeton dans le genre.
Surtout que le meilleur morceau du disque, la tuerie, c’est justement un morceau pop. Enfin, une pop en décomposition, noyée sous les rats et les sentinelles à mille pattes.
The Hole, commence par une superbe mélodie éthérée, (assez similaire à certains exercice de Moderat d’ailleurs, genre “3 minutes Of” ou “Les Grandes Marches”, histoire de replacer) un lit d’échos, avec guitares lancinantes, superpositions de sonorités cristallines. Et Raoul Sinier, qui nous conte une histoire, de nouveau, d’un homme malade. D’un mec qui se défigure, qui se creuse un trou au milieu de la tête. “Sunday morning, I had the urge to put a hole in place of my face / That’s not sad, there is nothing to worry about / Surprisingly i can see / I can store Small things in the Hole” Et vlan reveil rythmique, chair de poule, ça explose de partout, mélodie superbe, clochettes célestes, ça file directement au dessus des nuages. Ca reste tout cassé, le morceau se brise, éclate, puis revient à ses premiers amours après une dernière attaque, en repassant sur cette plage céleste pleine d’échos. A partir de 2min30 ça redevient calme et superbe, tu ne sait plus ou t’es, on vient de te casser la gueule. Pour l’anecdote, le bonhomme de l’histoire semble finalement avoir pris ses calmants, et s’emmerde avec son trou au milieu du visage, alors il le referme. Pas trop grave nous dit Raoul Sinier, malgré des coutures et agrafes un peu dégueulasses, le résultât n’est pas trop gênant.
Sinon, il y a Boxes, le summum de la gangrène rongeant Tremens Industry, qui démarre sur un Hiphop pépère et une mélodie claudicquante. La voix, hésitante, est encore plus désenchantée. Un mec perdu, dépassé par son corps, qui demande de l’aide pour ne pas devenir fou. Grosse explosion, ça va hurler dans le fond, le gars vient peut être de s’ouvrir le ventre, on ne sait pas trop, et le morceau devient dingue, déluge de rythmiques qui nous tombe sur la thrombine, avant une conclusion qui semble te tendre la main une dernière fois avant de tomber dans un gouffre. Sérieux, la mélodie est viciée. Le chant est malade, les rythmiques sont détraquées. L’atmosphère du tout est froide comme la mort. Un morceau lépreux, encore vivant mais recroquevillé dans son coin, à lever les yeux vers le ciel pour demander un peu d?aide.
Et comme s’il fallait nous convaincre, le morceau débouche directement sur Confusion Room, dernière protestation du futur cadavre, dernier sursaut de raison d’un cerveau embrumé par la folie et les cachetons. On frôle les 200bpm, choeurs/plaintes bizarres jetées sur ce maelstrom hardcore industriel, claviers qui s’emportent, t’as l’impression que l’on veut t’arracher le visage. Et quand la track se pose peu à peu, que le tabassage se calme, c’est pour laisser graduellement crever les synthés.
Boxes / Confusion RoomC’est un peu le turning point du disque : après l’écoute de ce morceau, on revient sur le départ de la galette, on la réécoute, et l’on se dit que finalement, le tout n’était pas si guilleret, pas si naïf, que tout semble tendre à cet espèce de pétage de plomb paranoïaque. C’est surement ces deux morceaux qui offrent une nouvelle relecture du disque, moins détachée, presque flippante. On a alors l’impression que chaque morceau est une peinture d’un problème mental, d’un nervous breakdown, d’une hallucination. De toute façon, tout semble tendre vers ceci, du nom des titres aux images de la pochette, en passant évidemment par le clip de Tremens Industry.
Au final, seul Sand Skull n’accroche pas trop, et l’on regrette que l’énorme Hiphop complètement défoncé et fracturé de List Of Things soit parasité par un texte pas foncièrement indispensable, car mettant trop en retrait les anfractuosité d’un morceau qui semble être fou en arriere plan.
Le dernier titre, Hard Summer filera une nouvelle claque. On prend peur au départ, en entendant ce rythme ultra saturé, ce gros mur shoegaze cradingue, similaire à une chute d’immeuble dans la tronche. (pas si éloigné de la conclusion de Wxfdswxc2 d’ailleurs, mais en beaucoup plus dense) Mais au milieu du marasme, il y a encore des petites clochettes, toutes belles, toutes fragiles, qui se débattent, qui chialent une parfaite mélodie. Peut être le morceau le plus violent du disque, et en même temps le plus beau, le plus aérien, sorte de recueillement complètement ravagé et mélancolique.
C’est le disque le plus posé de Raoul Sinier, oui, mais c’est pas le plus simple d’accès. C’est toujours une histoire de machines qui se font crucifier, de musiques qui se déchirent, de rythmes ravagés. Certes. Mais c’est aussi, et surtout un disque malade, imprimant constamment une dualité étrange, malsaine.
Car de la Pop bizarre de The Hole, jusqu’à l’attentat de Map of a Tactical Nonsense, en passant par les litanies bizarres des deux Overthoughts, la faucheuse nauséeuse de Boxes, l’électronique de Tremens Industry, ou This Little Mouse, tout semble tendre à cette espèce d’aliénation mentale. Dans l’imagerie aussi, entre Ra qui traine un bout de barbaque dans la rue, s’inventant un ami imaginaire pour tromper la solitude, ou assailli par ses multiples personnalités dans le court métrage la peau du soldat. Seul le clip d’Alternative Rush tranche avec le tout, offrant un rigolo dessin animé pour enfant, amitié entre un robot et un rat (à la tronche impayable) en quête de fromage.
Bref, ce n’est plus une histoire de monstres marrants qui nous est conté ici, mais bien celle d’un mec qui perd la boule. Et pour cela, Raoul Sinier utilise toujours aussi bien ses machines, qui risquent vraiment de lui claquer entre les mains après un tel traitement : Rythmiques de folie, claviers toujours copyrightés RA, avec une ouverture de sa musique vraiment appréciable, portant le tout vers d’autres rivages. On pourrait limite prendre les trois derniers albums comme une trilogie à la suite logique, parfaitement menée, de l’electro imparable de Wxfdswxc2 au chaos radical de Brain Kitchen, pour finir sur la dépression camée de Tremens Industry.
Encore un énorme album, qui te donne juste envie de braquer une pharmacie après écoute. Plonger dans une musique électronique remplie de problèmes mentaux, moignons, schizophrènes et cellules capitonnées ne se fait évidemment jamais sans risque.
Raoul Sinier – The Hole (Teaser)
Raoul Sinier – Tremens Industry
Raoul Sinier – Album Teaser 1
13 Titres – Ad Noiseam
Dat’